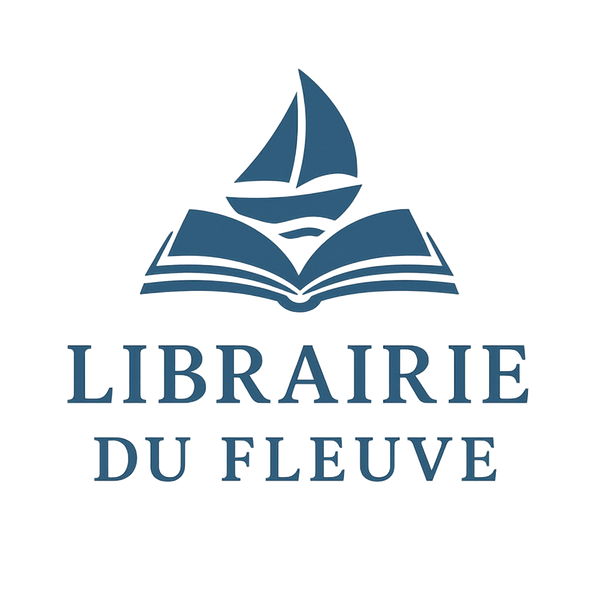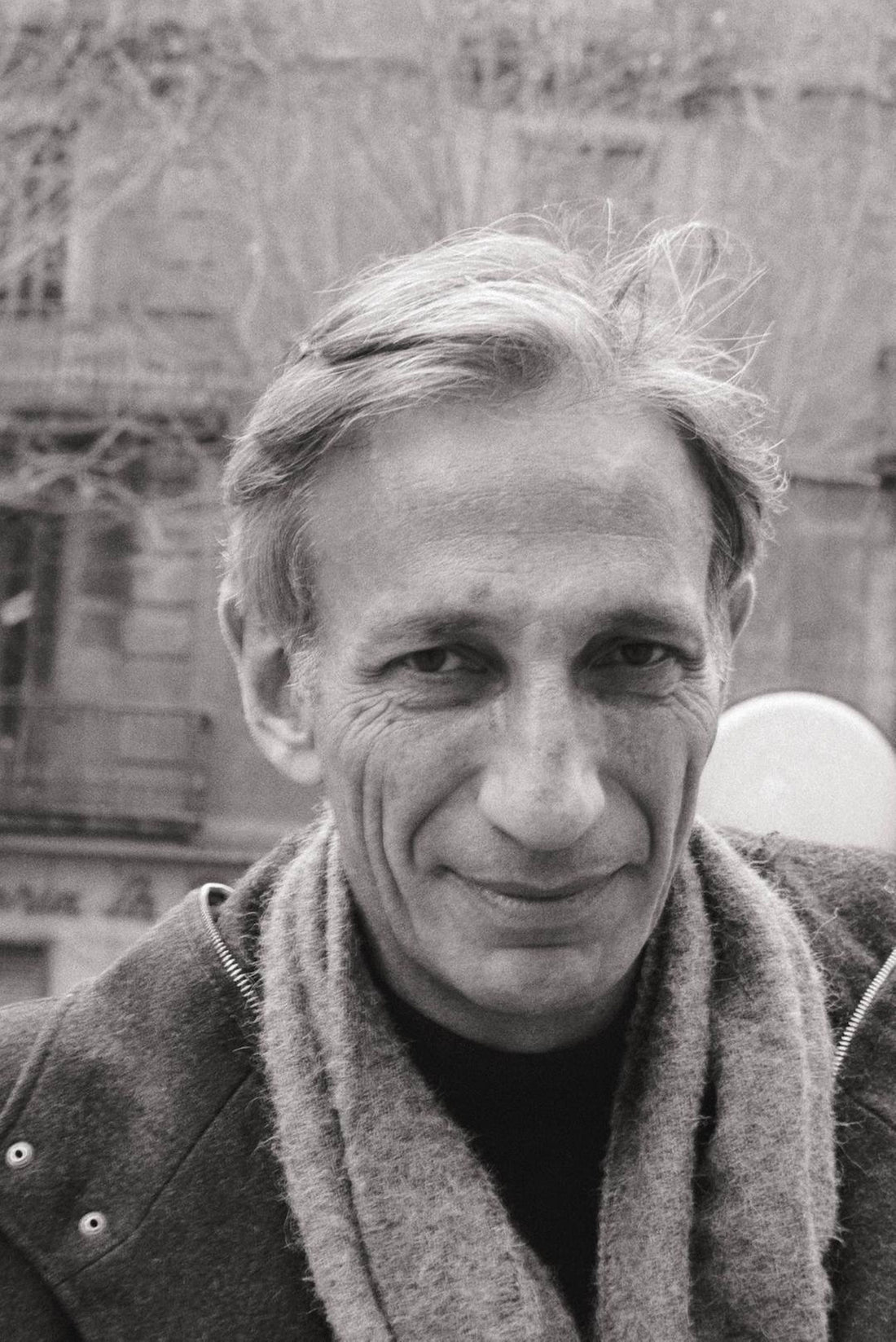
Lumière sur: Ivan Illich
Christophe HébertShare
Dans la rubrique "Lumière sur" de ce blog, je mettrais régulièrement en vedette des auteurs et penseurs importants, des gens qui ont façonné le monde en le remettant en question de leur plume.
Lumière sur: Ivan Illich (1926-2002)
Ivan Illich: prêtre, penseur, quasi-philosophe (dans le bon sens...), critique de la société technicienne, précurseur de l'écologie... Comme c'est souvent le cas avec les grands penseurs de ce monde, il est très difficile de catégoriser la contribution de M. Illich dans une seule case, mais si on devait se réduire à le faire, on se devrait de choisir le mot qu'il employait lui-même si souvent, ce mot qui lui était si cher: penseur de la convivialité.
La convivialité était centrale dans toute l'oeuvre d'Illich, et, comme la liberté pour Bernard Charbonneau, son oeuvre ne peut être comprise sans cerner ce concept. Il l'expliqua, évidemment, le mieux dans son livre La convivialité (1973), mais pour faire rapidement: la convivialité est, à la toute base, la qualité d'une société où l'outil est au service de l'être humain, plutôt que le contraire. De là se décline toute une série d'exigences pour qu'une société puisse être considérée conviviale, par exemple: que l'outil soit à l'échelle humaine (dans son temps et son espace) et qu'il encourage l'autonomie de la personne; qu'elle encourage le "faire ensemble" plutôt que le "faire faire"; qu'elle favorise l'équilibre entre l'homme et la technique (sans rejeter la technique, ce qui est une proposition absurde) pour que cette technique ne soit ni aliénante ni totalisante; qu'elle soigne son environnement naturel en utilisant exclusivement des outils et des moyens qui ne l'agresse pas de manière violente et irréparable. Ceci n'en représente évidemment que quelques critères parmi plusieurs.
On le comprendra bien: la société conviviale d'Illich est presqu'exactement l'inverse de la société technicienne, et à partir de cette définition, il s'attaquera à plusieurs monstres sacrés de la deuxième moitié du XXè siècle et de son idéologie héritée de la classe bourgeoise transformée en société bourgeoise: la médecine dans Némésis médicale (1975), l'école dans Une société sans école (1971), la production et la consommation énergétique qui mène à la dégradation des rapports sociaux dans Énergie et équité (1973), l'aliénation à laquelle mène le travail non-rémunéré auquel nous nous devons de nous soumettre pour devoir simplement exister dans la société technicienne dans Le travail fantôme (1981), ce qui mena, en particulier, à la situation outrageuse et inacceptable de la femme au foyer.
Il fût aussi vertement critiqué pour son texte Le genre vernaculaire (1982), texte qui a été, si je puis me permettre un commentaire éditorial, profondément mal compris. Illich écrit, dans ce livre, sur la différence entre le genre et le sexe, un thème qui est toujours, de nos jours, d'actualité. Pour lui, le genre est bien l'une de ces fameuses "constructions sociales"; mais il s'agit d'une construction "vernaculaire", c'est-à-dire qui existe en dehors des exigences du marché économique et de l'influence de l'argent; un concept qui est donc à l'échelle humaine (ce qui en fait alors, évidemment puisqu'humain, un concept imparfait! Illich ne célébrait aucunement une supposée "perfection" ou "intouchabilité" du genre comme construction sociale). Il s'agit donc, si l'on veut combattre ce système économique non-équitable, conserver cette construction; elle ne mérite, pour lui, pas les attaques auxquelles elle était soumise, du moins pas par l'angle duquel elle l'était, car la "déconstruction" de celle-ci n'est pas une célébration de l'être humain libéré des chaînes d'une société écrasante, mais au contraire, la conséquence logique de l'avènement de la société économico-technique du XXè siècle, qui veut détruire le genre pour le remplacer par le "sexe", qui est marchand, économique et industriel. Détruire le genre est donc une soumission radicale qui se donne des airs de grande libération, comme le sont plusieurs "progrès" engendrés par le système contemporain.
Évidemment, il faut donc se situer entièrement en dehors des principes de la société économico-technique pour comprendre les conséquences réelles de l'argumentaire d'Illich: on voit ainsi que la toute dernière chose qu'il souhaite, par exemple, c'est le retour de la "femme au foyer", un rôle qui pour lui était profondément aliénant et inhumain. Malheureusement, il s'agit d'un exercice difficile à accomplir pour l'être moderne et le texte fût très mal compris et rapidement oublié. Je vous invite à le revisiter avec l'esprit ouvert.
Pour conclure sur M. Illich, nous soulignerons ceci: il était l'un des penseurs radicaux majeurs du XXè siècle à non seulement "penser" et écrire ses idées fascinantes, originales et nécessaires, comme j'espère l'avoir communiqué de façon satisfaisante plus haut, mais il était aussi l'un des rares à proposer, dans pratiquement chacun de ses livres, des actions concrètes que l'on puisse, ou pourrait, prendre pour engendrer des changements au moins au niveau de nos propres vies. Évidemment, cette idée de changement seulement au niveau du personnel n'est pas à l'abris des critiques (justification, bien-pensance, satisfaction de soi et repli sur soi-même, etc), mais Illich proposait aussi des changements au niveau sociétal dans lesquels ces changements personnels s'inscrivait.
Et, il faut le souligner, le changement personnel dans le contexte de la convivialité est aussi ce qui entraînerait les changements sociétaux, car la société à l'échelle humaine aurait une orientation de "bas en haut", plutôt que de "haut en bas". Ainsi pensait Monsieur Illich, l'une des figures majeurs et aujourd'hui malheureusement un peu oubliées de la critique de la société technicienne.